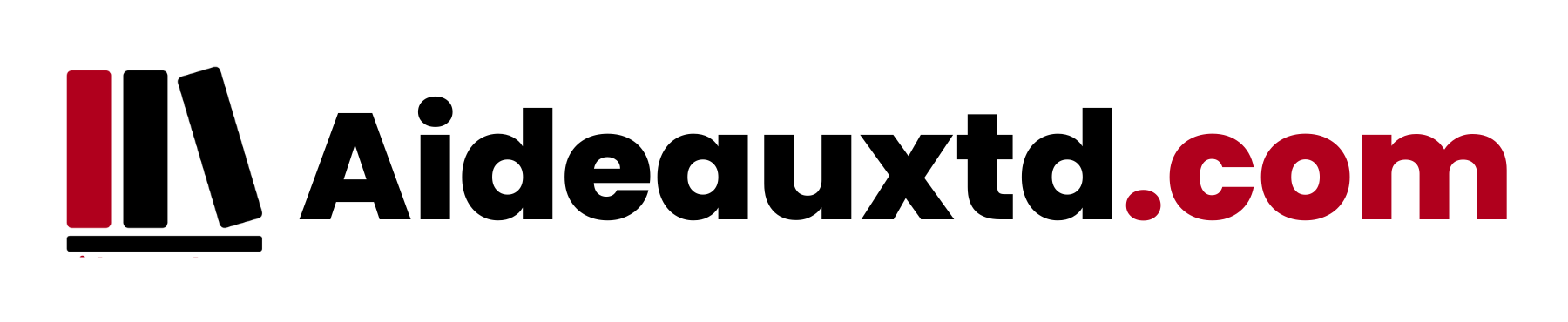Cours de droit des contrats pour réussir vos partiels
Cours de droit des contrats et exercices corrigés de droit des contrats (cas pratiques, commentaires d'arrêts, dissertation...).

Tous les cours de Droit des contrats sur le blog

Tous tes cours au même endroit pour obtenir la moyenne à tes partiels de droit.
17 matières fondamentales de la L1 à la L3 (en vidéo et à l'écrit) par des enseignants d'exception pour apprendre facilement, s'entraîner avec des centaines d'annales et obtenir la moyenne à coup sur.
Comment définir un contrat ?
Le texte de référence est l'article 1101 du Code Civil :
Selon l'ancienne définition, un contrat est une « convention par laquelle une, ou plusieurs personnes, s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose ».
La loi du 16 février 2015 a autorisé le Gouvernement à réformer le droit des obligations par voie d’ordonnance, afin « de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité et de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats ». La loi de ratification a été promulguée le 20 avril 2018, publiée le 21 avril 2018, entrée en vigueur le 1er oct. 2018 et modifie légèrement le droit des contrats issu de l'Ordonnance.
Dans la nouvelle définition, le contrat est un : « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
On substitue au terme de conventions celui d’accord de volonté. Désormais, la définition du contrat est plus large et un certain nombre d’opérations d’actes juridiques, qui avant ne relevaient pas de la définition du contrat, sont absorbés par le contrat.
Quel est l'origine et le but du contrat ?
L’accord de volonté est le critère distinctif du contrat.
Ainsi, il faut deux volontés qui s’accordent pour former un contrat. Une volonté unilatérale ne suffit pas à la formation d’un contrat.
Ce critère permet de distinguer le contrat de l’acte juridique unilatéral et de l’engagement unilatéral de volonté.
L’accord doit intervenir en vue de créer des droits : « destiner à créer, modifier, transmettre, éteindre ». Il faut une intention d’être lié juridiquement. Ainsi, sur la base de ce critère, deux types d’actes s’opposent au contrat :
1. Distinction du contrat avec l'acte de courtoisie et l'acte de complaisance
Exemple d’acte de courtoisie : invitation à un dîner acceptée par celui qui l’a reçoit mais annulée au dernier moment par la personne qui invite.
Exemple d’acte de complaisance (prestation de services ponctuelle et gratuite) : vous aidez quelqu’un à déplacer un meuble.
2. Distinction du contrat avec l'engagement sur l'honneur
Exemple d'engagement sur l'honneur : Une société s’était engagée moralement « à ne pas copier » les produits commercialisés par une autre société. La Ccass juge que cet engagement est une clause qui avait une valeur contraignante pour l'intéressée (Com., 23 janv. 2007, 05-13.189).
Quelle est la classification des différents types de contrats ?
Ces classifications doivent être connues car l’application de certaines règles découlent parfois de la qualification de tel ou tel type de contrat.
1. Les contrats nommés / innommés
Contrats nommés : contrats dont le régime est précisé par la loi. Exemple. : contrat de vente / de bail.
Contrats innommés : créés par la pratique en vertu du principe de la liberté contractuelle. Ils n’ont pas de régime détaillé par une loi particulière. Exemple : contrat de déménagement.
2. Les contrats synallagmatiques / unilatéraux
Contrats synallagmatiques : les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il fait naître des obligations qui pèsent sur les deux parties.
Exemple, le contrat de vente : le vendeur doit délivrer la chose et garantir l’acheteur contre les vices cachés qui peuvent affecter la chose, l’acheteur est tenu de l’obligation de payer le prix de la chose.
Contrats unilatéraux : une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Il ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une des parties. Exemples : le contrat de cautionnement car seule la caution s’oblige envers le créancier.
3. Les contrats à titre onéreux / contrats à titre gratuit
Contrat à titre onéreux : chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
Contrat à titre gratuit : une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
4. Les contrats commutatifs / contrats aléatoires
Contrat commutatif : chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. La contrepartie que chaque contractant reçoit est d’ores et déjà certaine et déterminée. Exemple : Le contrat de vente car sa validité suppose dès sa conclusion que la chose et le prix soient déterminés ou au moins déterminables.
Contrat aléatoire : les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. Exemple : Le contrat d’assurance car ni l’assureur ni l’assuré ne savent quels avantages ils retireront du contrat au moment de sa conclusion.
5. Les contrats consensuels / solennels / réels
Contrats consensuels : se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Sa validité n’est subordonnée à aucune condition de forme. Tout contrat est en principe consensuel, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Exemple : Achat d’une baguette de pain.
Contrats solennels : sa validité est subordonnée à des conditions de forme déterminées par la loi. La loi exige que le consentement soit donné sous certaines formes. Exemple : La donation suppose la rédaction d’un acte authentique.
Contrats réels : sa formation est subordonnée, en plus de l’échange des volontés, à la remise d'une chose. Exemple : Le contrat de prêt d’argent est un contrat réel car formé au moment de la remise de l’argent.
6. Les contrats de gré à gré / contrats d’adhésion
Contrats de gré à gré : celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Contrats d’adhésion : comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Exemple : Contrats liés à la consommation, contrat entre particuliers/compagnies d’assurance
7. Le contrat cadre et contrat d’application
Le contrat cadre est l'accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures et le contrat d’application est celui qui en précise les modalités d’exécution.
8. Les contrats à exécution instantanée /à exécution successive
Contrat à exécution instantanée : celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Ex. : contrat de vente (dès la remise de la chose et le paiement du prix le contrat est exécuté).
Contrats à exécution successive : celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Ex. : contrat de travail, contrat de bail.
Pourquoi des cours de Droit des contrats en ligne?
L'objectif est de mettre à disposition des étudiants des cours de droit en ligne gratuits afin de les aider à réussir leurs études de droit et à progresser dans la matière de Droit des contrats. Il ne s'agit pas, comme certains sites internet le proposent, de mettre en ligne des cours pris en note en amphithéâtre par des étudiants en droit et de les retranscrire sur ce site.
Tous les cours de droit des contrats sont rédigés spécialement pour les lecteurs de Aideauxtd.com et ne figurent nulle part ailleurs. L'objectif est de rendre la matière la plus claire et accessible possible. Tous les cours proposés poursuivent le même but : vous aider à augmenter vos notes en vue des prochains partiels de droit des contrats !
Pour aller plus loin, vous trouverez également sur ce site de nombreux cours de méthodologie juridique, des conseils pour réussir vos études de droit ainsi que des exercices corrigés (cas pratique, fiche d'arrêt, dissertation, commentaire d'arrêt).
Qui rédige les cours de droit des contrats ?
Avocat de formation (anciennement inscrit au barreau de Nice), diplômé de l'école de formation du barreau de Paris, chargé d’enseignement à l’université et titulaire d'un Master 2 de l’université Panthéon Assas, Raphaël est passionné par l’enseignement juridique et par la réussite de ses étudiants.
- Raphaël briguet-lamarre