La dénonciation est un acte émanant d’une partie à une convention ou à un accord collectif par lequel elle se déclare déliée pour l’avenir de cette convention ou de cet accord collectif. Par la dénonciation, elle met un terme à ses engagements. Les règles relatives à la dénonciation sont prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
I. Domaine de la dénonciation (C. trav., art. L. 2261-9)
Seuls laconvention ou l’accord collectif à durée indéterminée peuvent être dénoncés. La convention ou l’accord collectif à durée déterminée ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation.
1. Comment savoir si la convention ou l’accord collectif est à durée déterminée ou indéterminée ?
Avant la loi du 9 août 2016, le principe était qu’en l’absence de disposition la convention ou l’accord collectif était à durée indéterminée. Les parties pouvaient par exception prévoir que la convention ou l’accord collectif serait à durée déterminée pour une durée maximum de cinq ans. À l’expiration de ce délai, la convention ou l’accord collectif continue à produire ses effets comme une convention ou un accord collectif à durée indéterminée sauf stipulation contraire (Soc., 28 sept. 2010, n°09-13.708).
Après la loi du 8 août 2016, en l'absence de disposition particulière, la convention ou l’accord collectif est à durée déterminée (durée fixée, par défaut, à cinq ans). À l’échéance, la convention ou l’accord collectif à durée déterminée ne se transforme pas en convention ou accord collectif à durée indéterminée, mais cesse simplement de produire ses effets (C. trav., art. L.2222-4).
Les parties doivent donc désormais expressément prévoir que la convention ou l’accord collectif est à durée indéterminée.
2. Quelles sont les règles relatives à l’application de la loi du 8 août 2016 dans le temps ?
Les anciennes dispositions restent applicables aux conventions et accords collectifs conclusjusqu’à la publication de la loi soit le 10 août 2016.
II. Conditions de la dénonciation (C. trav., art. L.2261-9)
1. Type de dénonciation : dénonciation totale. La dénonciation doit porter sur la totalité de la convention ou de l’accord collectif. La dénonciation partielle (par exemple ne visant que certains avenants ou annexes) est nulle sauf clause contraire de la convention ou de l’accord collectif (Soc., 16 mars 1995, n°93-13.371).
2. Auteurs de la dénonciation. La dénonciation peut être réalisée par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés (C. trav., art. L2261-10). Si la convention ou l’accord collectif a été étendu, l’arrêté d’extension devient caduc. La convention ou l’accord collectif cesse de produire ses effets (C. trav., art. L2261-28).
La dénonciation peut également être réalisée par une partie des signataires employeurs (pour les conventions ou accords collectifs de branche). La convention ou l’accord collectif ne reste applicable qu’aux employeurs qui ne l’ont pas dénoncée. En revanche, si la convention ou l’accord collectif en question a été étendu, la dénonciation n’a aucun effet sauf lorsque la dénonciation émane d'une organisation seule signataire concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence (C. trav., art. L. 2261-12).
Enfin, la dénonciation peut être réalisée par une partie des signataires salariés (C. trav., art. L. 2261-10 al 4). S’agissant des conventions ou des accords collectifs d’entreprise, la dénonciation produit ses effets lorsqu’elle émane de l’employeur mais elle doit être totale lorsqu’elle émane des syndicats de salariés.
3. Formalisme de la dénonciation. La dénonciation doit être notifiée à tous les autres signataires (C. trav., art. L2261-9) à défaut de quoi elle ne produit aucun effet.
Elle doit être déposée comme une convention ou un accord collectif classique (C. trav., art. L. 2261-9).
Avant la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015, la dénonciation d’un accord d’entreprise nécessitait la consultation préalable du comité d’entreprise (Soc., 5 mars 2008, n°07-40.273). Cette condition est supprimée.
III. Effets de la dénonciation (L2261-9 à L2261-13)
Afin d’éviter que la dénonciation ne soit trop brusque, le Code du travail encadre les effets de la négociation.
Première phase : L’existence d’un préavis de 3 mois (C. trav., art. L2261-9)
Un préavis de 3 mois suit la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif (en l’absence de disposition expresse prévoyant une autre durée).
Deuxième phase : Au terme du préavis, une période de négociation légale de 1 an pour conclure un accord de substitution (C. trav., art. L. 2261-13).
L’accord de substitution peut être négocié dès le début du préavis et entre en vigueur dès sa conclusion même si le préavis n’est pas encore écoulé (C. trav., art. L2261 al 2) ce qui n’était pas le cas avant la loi « Travail » du 8 août 2016 puisqu’il fallait attendre l’expiration du préavis.
Cet accord de substitution est négocié selon les conditions ordinaires de validité des conventions et accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-1 et s.) ce qui implique notamment la convocation par l’employeur de l’ensemble des syndicats représentatifs.
Enfin, pendant le maintien provisoire de la convention ou de l’accord collectif dénoncé (en pratique d’une durée de 15 mois : 3 mois + 12 mois) la convention ou de l’accord collectif dénoncé reste obligatoire (Soc. 26 mai 1998, n°96-41.053) et s’applique donc aux salariés nouvellement embauchés.
Troisième phase : La fin de la période de négociation
Première hypothèse : Un accord de substitution est conclu
La convention ou l’accord collectif cesse de produire effet dès qu’un accord de substitution est conclu pendant la période de survie (C. trav., art. L. 2261-10). Le nouvel accord, une fois conclu, se substitue de plein droit à la convention ou à l’accord collectif dénoncé même s’il est moins favorable (Soc., 27 juin 2000, n°97-43.379).
L’accord de substitution met fin à la survie de la convention ou de l’accord dénoncé et ne permet pas le maintien du niveau de rémunération des salariés.
Deuxième hypothèse : Aucun accord de substitution n’est conclu
Avant la loi « Travail » : Maintien des avantages individuels acquis (AIA)
L’ancien article L. 2261-13 du Code du travail prévoyait que le maintien en vigueur provisoire de l’AC dénoncé s’achevait mais que les salariés conservaient les « avantages individuels qu’ils ont acquis » qui devenaient contractuels. L’employeur ne pouvait donc les supprimer sans le consentement des salariés.
Depuis la loi « Travail » : Garantie de rémunération (C. trav., art. L. 2261-13)
Les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord collectif dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
L’article vise la rémunération au sens de L. 242-1 du Code de la sécurité sociale c’est-à-dire tous les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale ce qui exclut les remboursements de frais professionnels, la participation ou l’intéressement.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était due au salarié en vertu la convention ou de l’accord collectif dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant du nouvel accord collectif, s'il existe, et de son contrat de travail (C. trav., art. L. 2261-13 al 2).
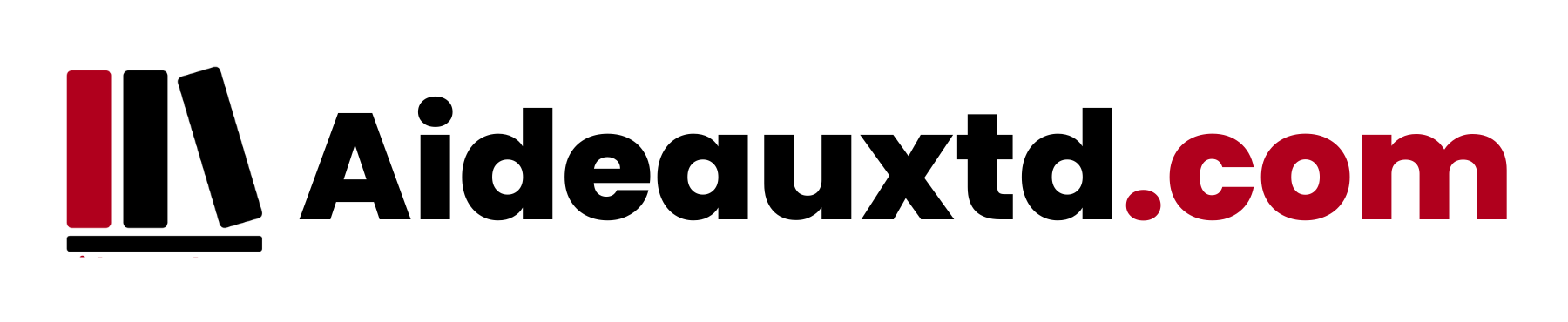






Bravo, ce blog est tres complet, je vais le conseiller a nos apprenties en master 2 dpse!
Merci à vous.